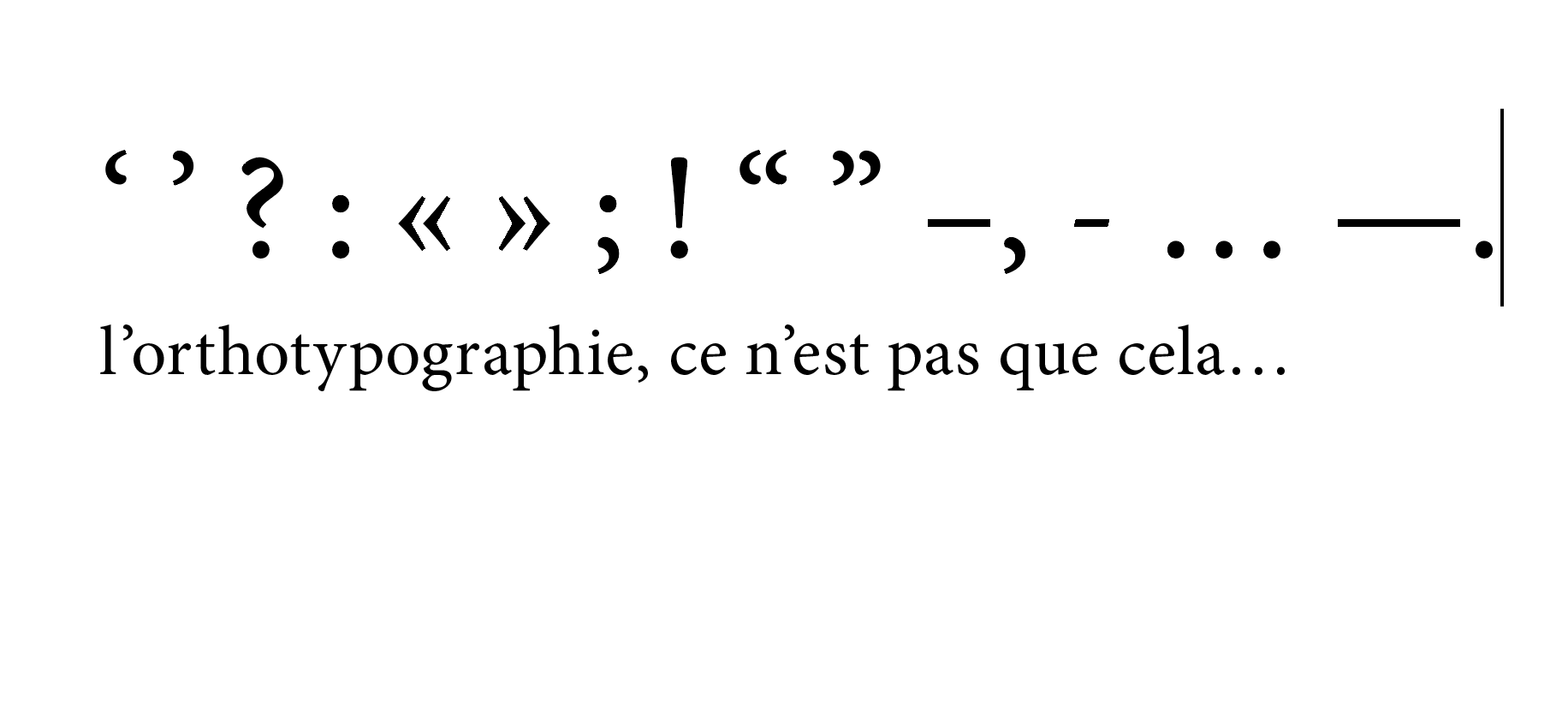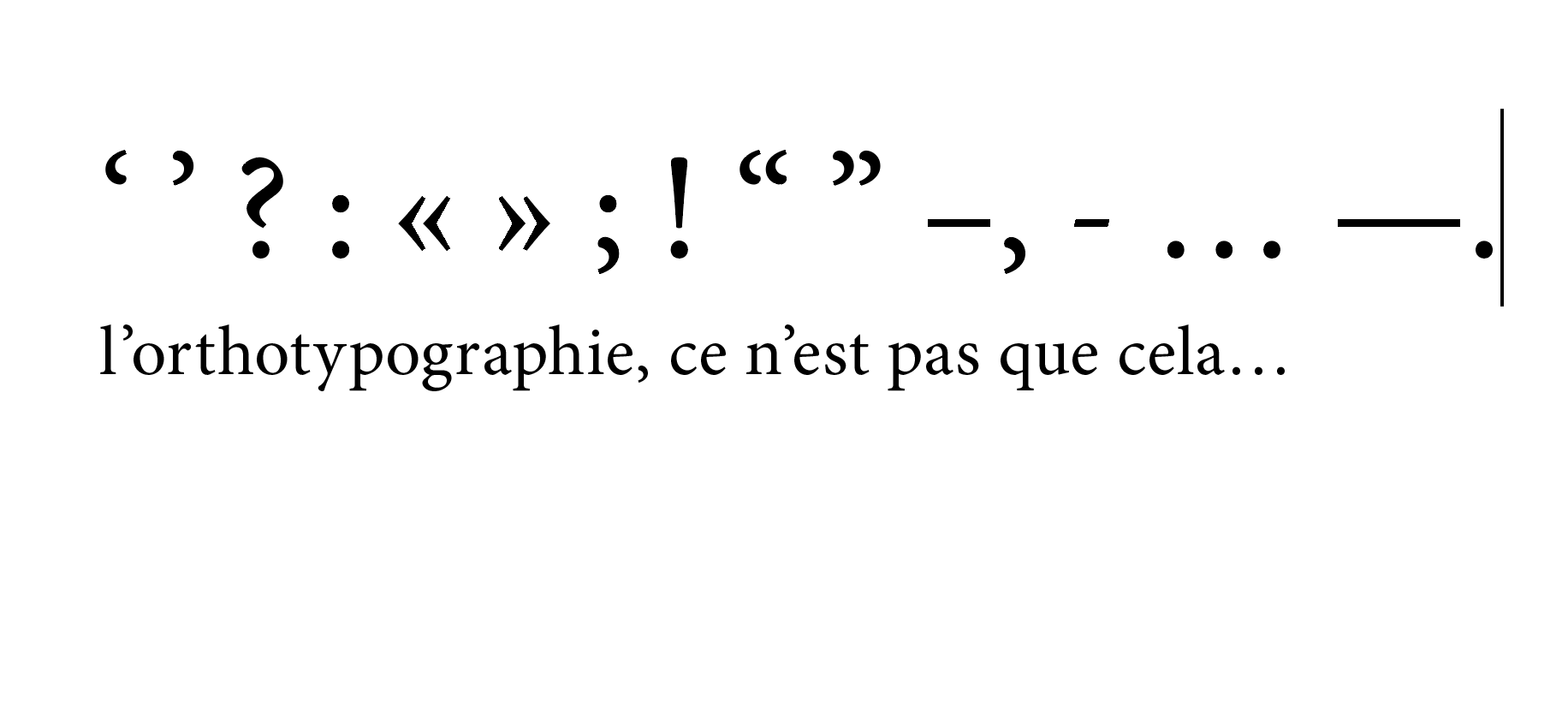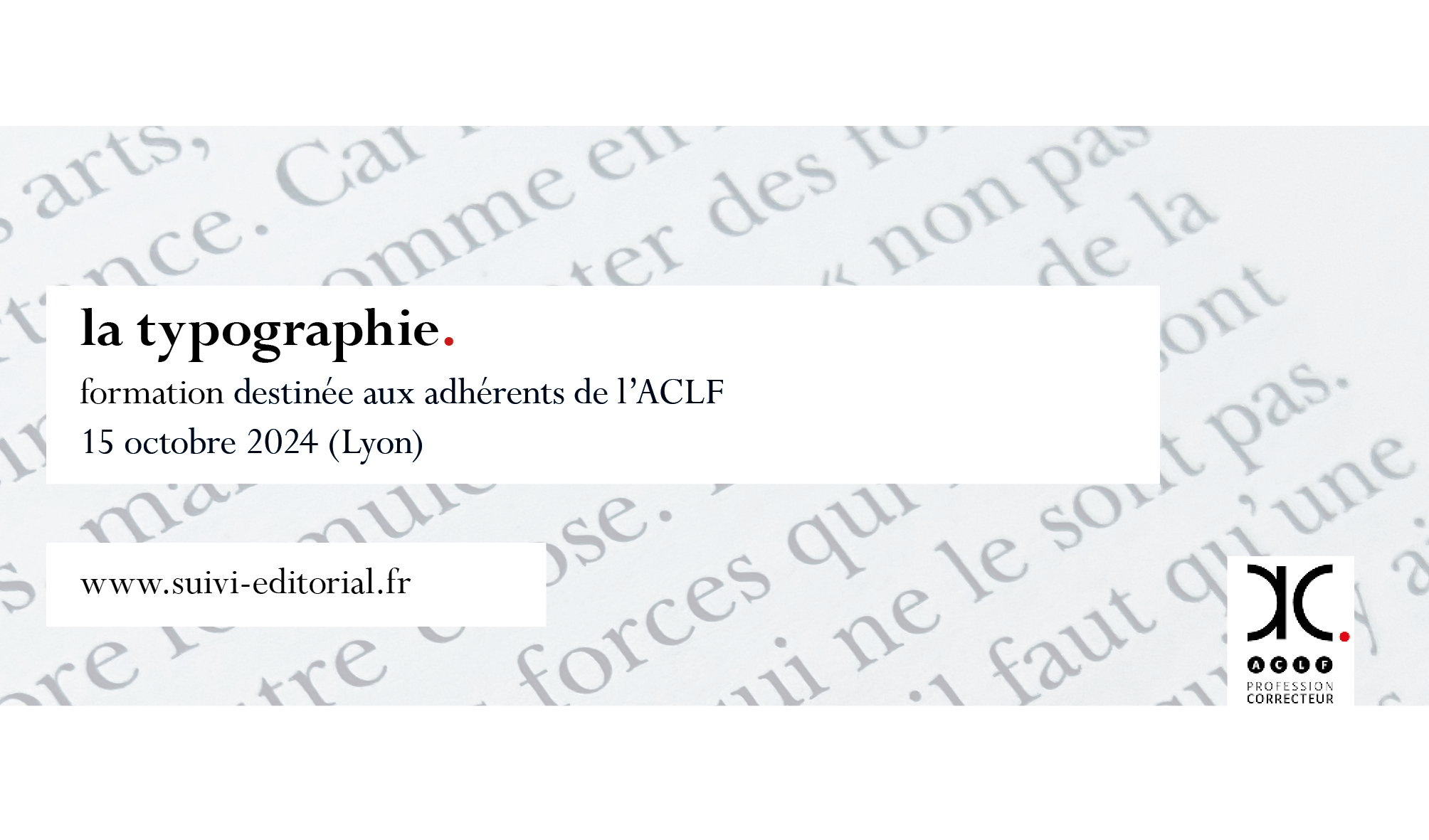Tous les papiers :
- Choisir un papier -
Roméo Mivekannin
L’Olympus Pen ou le plaisir du double
In-folio
In-folio, objet imprimé
L’horizon sans fin
Lova [Héritage], photographies d’Antananarivo
Découvrir les règles de l’orthotypographie pour optimiser la qualité éditoriale de sa revue
Sens et lisibilité
L’orthotypographie
La mémoire mise en page
Charles the First
La bibliographie
Le texte comme la montagne
I cross out words
20 ans en 2023
À la française
La bibliodiversité, ou l’enjeu de la diversité éditoriale
Une carte mentale pour corriger la biblio
Profession : correcteur
Écrire la préface de son propre livre : simulacre ?
Livre avec vue…
Poétique des ruines : Detroit
Profession : correcteur
Renaissance
20/20
Poétique des ruines : La Havane
Association des correcteurs de langue française
Thomas Paine
Un petit pan de mur jaune
Mise en pages ou mise en page ? (3)
Le livrarium
Mise en pages ou mise en page ? (2)
Joyaux de la collection Al Thani
Les anges au Japon
IAM Intense Art Magazine
Préparer un texte de recherche en sciences humaines et sociales dans un contexte d’édition multisupport
Dans le noir, j’écoute
Benjamins Media, « 100 % sensoriel »
Les métiers se livrent
La psychologie du correcteur
Garamont ou Garamond ?
Très belle année 2015
Pomme c Pomme v Pomme c Pomme v Pomme c Pomme v
Le Mistral
10 ans en 2013
Mise en page ou mise en pages ?
Définition
Comment se porte l’édition scientifique publique ?
La fin des services de correction ?
Paris est une fête
Souvenirs de la maison des mots
Orthotypographie par Jean-Pierre Lacroux
Éditions Claire Paulhan
35 ans de corrections sans mauvais traitements
David Goldblatt
Bibliophilie sous le regard romanesque d’un promeneur érudit
Architectures africaines
Glifpix
L’Art des jardins en Chine
Flavia Cocchi
Histoires d’édition (II)
Histoires d’édition (I)
La couverture de livre
Oak Park
Pierre Buraglio
Un stage auprès d'une freelance ?
L'autre relecture
Édition électronique
Des correcteurs électroniques à l'école ?
Écriture jazz, écriture blues
Éditer la photographie
Le nouveau magasin d'écriture
Marbrures
Relire au Japon
Le prix unique du livre
Éditer en région
Rezonova
La préparation de copie
Le livre et l'éditeur
L’expérience
Un livre à mettre au frigo
Le Dit du Genji
L'atelier d'Alberto Giacometti
Un éditeur qui écrit
Votez pour les 7 merveilles du monde
Philippe Djian, Doggy bag
Le récit des 3 espaces
Alberto Giacometti
Leonardo Cremonini
Comment lire des livres que l'on n'a pas relus ?
Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?
Éditer pour le Web
Bonne année
Excellente année 2019
les papiers
Découvrir les règles de l’orthotypographie pour optimiser la qualité éditoriale de sa revue
Formation le 11 mars 2025Pôle revues Grand Ouest, URFIST de Rennes
COMPLET
Sens et lisibilité
L’orthotypographie
Cette formation s’adresse aux membres de l’ACLF . Lors de la préparation de copie et de la correction, le correcteur se doit de suivre les normes orthotypographiques applicables en édition. Cela requiert différents outils et des méthodes de travail sûres et efficaces. Le but de cette journée est de passer en revue les principales règles typographiques qu’un correcteur doit maîtriser.